« Les modèles de la cybernétique sont déjà post-structuralistes, ils ne sont modèles que d’eux-mêmes, ou bien d’autres modèles, miroirs de miroirs, spéculums ne réfléchissant aucune réalité. »
Jean-Pierre Dupuy
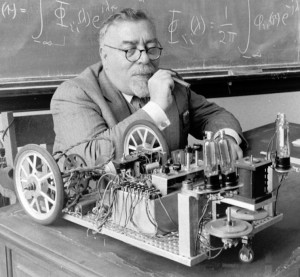 Rudement mises à l’épreuve par les visées belliqueuses du gouvernement Bush, les relations franco-américaines témoignent d’une profonde divergence d’esprit en matière de vision du monde et de valeurs démocratiques. Loin de se cantonner à la sphère diplomatique, le fossé de civilisation séparant la France des États-Unis se creuse davantage lorsqu’il est question de la vie universitaire et des mouvements de pensée. C’est ce que suggère de manière pour le moins paradoxale l’ouvrage récent de François Cusset consacré au succès outre-Atlantique de la French Theory [1]. Cocktail théorique regroupant les Lacan, Foucault, Deleuze, Guattari, Derrida, Lyotard et leurs innombrables acolytes, la French Theory constitue, il est vrai, l’une des principales sources philosophiques de l’Amérique postmoderne. Dépassant le cadre restreint des campus universitaires, l’influence des penseurs de la déconstruction, de la multitude et du « tout est langage » se répercute, comme le démontre bien François Cusset, jusque dans les politiques identitaires et la culture populaire américaine.
Rudement mises à l’épreuve par les visées belliqueuses du gouvernement Bush, les relations franco-américaines témoignent d’une profonde divergence d’esprit en matière de vision du monde et de valeurs démocratiques. Loin de se cantonner à la sphère diplomatique, le fossé de civilisation séparant la France des États-Unis se creuse davantage lorsqu’il est question de la vie universitaire et des mouvements de pensée. C’est ce que suggère de manière pour le moins paradoxale l’ouvrage récent de François Cusset consacré au succès outre-Atlantique de la French Theory [1]. Cocktail théorique regroupant les Lacan, Foucault, Deleuze, Guattari, Derrida, Lyotard et leurs innombrables acolytes, la French Theory constitue, il est vrai, l’une des principales sources philosophiques de l’Amérique postmoderne. Dépassant le cadre restreint des campus universitaires, l’influence des penseurs de la déconstruction, de la multitude et du « tout est langage » se répercute, comme le démontre bien François Cusset, jusque dans les politiques identitaires et la culture populaire américaine.
Cette étonnante popularité de la French Theory aux États-Unis a d’ailleurs suscité une vive controverse lors de « l’affaire Sokal ». Rappelons qu’à la suite de la publication d’un article pseudo-poststructuraliste dans la revue Social Text en 1996, le physicien Alan Sokal avait déclenché une polémique autour du relativisme épistémologique et des emprunts conceptuels propres à ce qu’il nommait le postmodernisme français [2]. Il n’en fallait pas plus pour que le débat prenne des accents patriotiques : Julia Kristeva alla jusqu’à accuser ses détracteurs de participer à une campagne antifrançaise, tandis que le sociologue Denis Duclot dénonçait la « francophobie » états-uniennes [3]. Véritable symbole de la prééminence intellectuelle de la France, la renommée américaine de la French Theory était alors présentée comme un succès d’importation.
Comment expliquer la postérité retentissante d’auteurs reconnus pour leur difficulté d’accès, leur hermétisme philosophique et leur usage de l’hyperbole, d’autant plus, comme le rappelle François Cusset, que la réception américaine des penseurs poststructuralistes est sans commune mesure avec celle que leur a réservée leur mère patrie ? Même en insistant sur la défrancisation et la décontextualisation des auteurs concernés, Cusset n’arrive toujours pas à s’expliquer pourquoi « pour un Français lisant un livre de Derrida […], dix Américains l’aient déjà parcouru, malgré la faible formation philosophique qui est la leur » [4]. Observant l’étrange concordance d’esprit entre l’éclatement culturel des mouvements identitaires américains et la pensée postmoderne et poststructuraliste importée de la vieille France, il note, à juste titre, que tout se passe « comme si l’Amérique et la théorie françaises se ressemblaient » [5]. Et si cette ressemblance était le résultat d’une origine commune, d’un ancrage proprement américain de la French Theory ? Et si cette fructueuse importation était plutôt l’indice d’une américanisation souterraine de la « pensée française » ? Non seulement cela permettrait de résoudre un paradoxe, mais, plus fondamentalement encore, de lever le voile sur un aspect méconnu de l’histoire intellectuelle contemporaine. On semble en effet avoir oublié ici l’influence déterminante de la cybernétique dans l’immédiat après-guerre.
L’après-guerre, la cybernétique et le triomphe de l’Amérique
Née au cœur du complexe militaro-industriel mis en place par le gouvernement américain durant la Seconde Guerre mondiale, la cybernétique correspond à une révolution paradigmatique dont on commence à peine à mesurer toute la portée [6]. Véritable matrice de la technoscience, elle a marqué les débuts de domaines aussi vastes que l’informatique, l’intelligence artificielle, les sciences cognitives, la biologie moléculaire, etc. Il faut dire que ses concepts d’entropie, d’information et de rétroaction avaient un potentiel d’application comparable à leur degré d’abstraction. Au-delà d’une simple importation conceptuelle, l’énorme retentissement scientifique et intellectuel qu’a connu la cybernétique au cours des années 1950 et 1960 est attribuable à la puissance d’inclusion de son modèle et à la nouvelle vision du monde dont elle était porteuse. Sur ce point, le sociologue Philippe Breton a montré comment le projet de créer une machine intelligente était, pour Norbert Wiener et ses collègues, étroitement lié au désir de combattre le chaos et le désordre engendrés par la guerre [7]. Définie comme la « science du contrôle et de la communication chez l’animal et la machine », la cybernétique avait pour mission de favoriser le traitement rationnel des informations afin d’organiser plus efficacement la société [8].
Procédant d’une dé-ontologisation, le modèle informationnel englobe tout autant l’humain que la bactérie, le vivant que la machine. Dans Cybernétique et société paru au début des années 1950, Norbert Wiener déclarait en ce sens :
« Il n’y a pas de raison pour que les machines ne puissent pas ressembler aux êtres vivants dans la mesure où elles représentent des poches d’entropie décroissante au sein d’un système où l’entropie tend à s’accroître. » [9]
Sans s’en douter, le père de la cybernétique inaugurait ainsi une nouvelle ère ; celle de l’information, du cyborg et de la déconstruction.
Loin de se limiter à son berceau géographique, l’ancrage américain de la cybernétique s’enracine, du point de vue épistémologique, dans son lien de filiation avec le béhaviorisme [10]. Premier mouvement de pensée affranchi de l’héritage européen, sa force d’attraction idéologique ne peut toutefois se comprendre que dans le contexte triomphant de l’après-guerre aux États-Unis. Acquis, en bonne partie, grâce à la bombe A, le prestige des scientifiques s’affirme alors avec le projet de créer une « machine intelligente ». Regroupant des chercheurs de renom et de tous horizons disciplinaires, les fameuses conférences Macy, qui s’amorcent en 1946, vont marquer le coup d’envoi de la révolution cybernétique [11]. Un coup d’œil sur la liste des participants de ces prestigieuses rencontres, où figurent des noms tels que John von Neumann, Heinz von Foerster, Gregory Bateson, Margaret Mead ou Roman Jakobson, suffit pour saisir l’importance historique de ces rencontres [12].
Les assises proprement américaines de la cybernétique, son ancrage dans la réalité sociologique de l’après-guerre aux États-Unis n’avaient pas échappé à son fondateur qui notait dans Cybernétique et société : « Ce livre est destiné principalement à des Américains vivant dans le milieu américain » [13]. Permettant d’asseoir la légitimé intellectuelle et scientifique de l’Amérique, la cybernétique devient, à la suite du plan Marshall et de l’expressionnisme abstrait, l’un des porte-étendards de la nouvelle puissance mondiale [14].
Structuralisme, pessimisme et anti-humanisme
Apparus presque simultanément à la fin des années 1940, la cybernétique et le structuralisme représentent tous deux une forme de réponse scientifique à la guerre et au nazisme. Nourrissant à la fois un optimisme technoscientifique et un profond pessimisme anthropologique, ils attestent de la perte de confiance en l’homme consécutive à l’effondrement des idéaux humanistes. D’un bord à l’autre de l’Atlantique, la remise en cause de l’héritage humaniste portée par le paradigme informationnel s’exprime toutefois dans des registres fort différents. Alors que Norbert Wiener s’est toujours considéré comme un humaniste, sans voir la profonde contradiction avec son modèle, Lévi-Strauss et les ténors du structuralisme vont, de leur côté, revendiquer haut et fort leur anti-humanisme et leur rejet de la figure du sujet. Tout se passe en fait comme si, du côté américain, le renversement épistémologique opéré par la cybernétique avait été ressenti beaucoup moins violemment qu’en France. Cette différence de position peut s’interpréter comme un indice que l’héritage humaniste était plus soluble aux Etats-Unis [15]. En ce sens, le nouvel humanisme annoncé par les cybernéticiens était déjà un posthumanisme. Curieusement, c’est avec l’importation structuraliste du modèle cybernétique que la rupture paradigmatique prendra tout son sens.
Idéologie de la fin des idéologies, le structuralisme prend rétrospectivement la forme du premier mouvement postmoderne, du moins dans son effort acharné à déconstruire le sujet. Si l’on peut difficilement évoquer cette période sans se référer à l’influence des figures emblématiques de Nietzsche, Heidegger et Kojève, il est néanmoins légitime d’affirmer que sans l’impulsion scientiste de la cybernétique, le structuralisme n’aurait pas eu un tel retentissement. Non seulement c’est dans l’univers cybernétique que Lévi-Strauss puise son modèle « d’esprit sans sujet » [16], mais tout le projet de l’anthropologie structurale sera d’amorcer cette « révolution copernicienne » qui consiste à interpréter la société dans son ensemble en fonction d’une théorie générale de la communication [17].
De retour en France en 1948, après un long séjour passé aux États-Unis, Lévi-Strauss ramène dans ses bagages les découvertes toutes fraîches de la cybernétique et de la théorie de l’information. Le programme structuraliste va se déployer sous l’impulsion immédiate du nouveau paradigme avec la parution de deux ouvrages canoniques soit Cybernetics de Norbert Wiener et The Mathematical Theory of Communication de Claude Shannon [18]. Comme le rappelle d’ailleurs l’historien François Dosse, « le succès du structuralisme en France est, entre autres, le résultat d’une rencontre particulièrement féconde en 1942 à New York entre Claude Lévi-Strauss et Roman Jakobson » [19]. Cette rencontre marque le rendez-vous historique du structuralisme et de la cybernétique par le biais de la phonologie structurale. Invité spécial de la cinquième conférence Macy, Jakobson est aux premières loges des discussions entourant la naissance de la cybernétique et de la théorie de l’information. Séduit par les possibilités théoriques qu’elles offrent, il entreprend d’aligner la phonologie sur leurs postulats. Comme il le précisera lui-même :
« Les concepts de code et de message introduits par la théorie de la communication sont beaucoup plus clairs, beaucoup moins ambigus, beaucoup plus opérationnels que tout ce que nous offre la théorie traditionnelle du langage [20]. Poussant encore plus loin la définition saussurienne de la langue comme système de valeurs différentielles, Jakobson conçoit la langue comme un code abstrait, décomposable en unités sonores et structuré par des lois invariables. Sur ce point, l’historienne des sciences Lily Kay a montré les liens étroits entre la linguistique de Saussure, la cybernétique et la phonologie où l’accent est mis sur le système de relation, sur les signifiants, plutôt que sur les référents ou les objets eux-mêmes. » [21]
Fasciné par les « méthodes mathématiques qui ont rendu possible la construction des grandes machines à calculer », Lévi-Strauss indique, dans un article de 1951, la voie par laquelle il espère intégrer les connaissances scientifiques issues de la cybernétique et de la théorie des informations [22]. Commentant Cybernetics de Wiener, il insistera sur le fait que son « importance ne saurait être sous-estimée du point de vue des sciences humaines » (ibidem). Le modèle cybernétique fournit à Lévi-Strauss non seulement l’assise scientifique de son anthropologie structurale, mais il nourrit son pessimisme anti-humaniste. Dans Triste tropique, publié au milieu des années 1950, il va jusqu’à proposer « de convertir l’anthropologie en enthropologie » [23]. L’horizon entropique de la cybernétique ressort avec encore plus d’éclat dans l’Homme nu que Lévi-Strauss conclut sur un ton apocalyptique :
« Il incombe à l’homme de vivre et lutter, penser et croire, […] sans que jamais le quitte la certitude […] qu’avec sa disparition inéluctable de la planète, elle aussi vouée à la mort, ses labeurs, ses joies et ses œuvres disparaîtront comme s’il n’avait jamais existé. » [24]
Difficile de ne pas y entendre les échos de la célèbre sentence de Norbert Wiener :
« Nous sommes des naufragés sur une planète vouée à la mort. » [25]
D’autant plus que Lévi-Strauss affirmera dans ces mêmes pages le caractère pacificateur et ordonnateur de la communication [26].
L’influence déterminante de la cybernétique dans la reconfiguration des sciences humaines en France durant les années 1950 et 1960 a aussi eu des répercussions importantes sur le plan institutionnel. Ainsi, le structuralisme ne se contente pas d’emprunter à la cybernétique certains de ses postulats théoriques, mais il reprend son projet d’unification de la science. Semblable à celle déployée par les cybernéticiens, la quête d’universalité dont fait preuve Lévi-Strauss l’amène à rêver que :
« l’anthropologie structurale, la science économique et la linguistique s’associeront un jour, pour fonder une discipline commune qui sera la science des communications. » [27]
Pour l’historien François Dosse, il ne fait pas de doute que la création de l’université de Vincennes en 1968 soit l’une des tentatives les plus poussées en ce sens : « Le projet est de faire de Vincennes un petit Mit, une université à l’américaine… » [28]. L’importation américaine du modèle cybernétique ne semble toutefois pas avoir été perçue comme tel. Ainsi, soulignant le faible ancrage institutionnel de la French Theory en France, François Cusset note, sans vraiment se l’expliquer, qu’elle est cependant « plus lue à Vincennes qu’à la Sorbonne » [29].
De Lacan à Derrida : la déconstruction cybernétique
Fortement influencé par le structuralisme, le psychanalyste Jacques Lacan consacre son séminaire de l’année 1954-1955 à la cybernétique et aux nouvelles machines à calculer [30]. Déclarant que « le monde symbolique, c’est le monde de la machine », Lacan affirme clairement dans ce séminaire l’empreinte informationnelle de sa pensée (ibidem, p. 70). Prenant pour exemple les machines cybernétiques, il donne sa définition de la subjectivité :
« Je vous explique que c’est en tant qu’il est engagé dans un jeu de symboles […] que l’homme est un sujet décentré. Eh bien, c’est avec ce même jeu, ce même monde que la machine est construite. Les machines les plus compliquées sont faites avec des paroles. » (ibidem)
Dans une conférence intitulée Psychanalyse et cybernétique, il précise que « la cybernétique est une science de la syntaxe » (ibidem, p. 417). Lorsqu’on connaît le rôle fondamental qu’occupe la syntaxe dans la linguistique structurale et, de ce fait, le rôle déterminant dévolu au signifiant, il n’est pas exagéré de voir dans la conception lacanienne du symbolique une transposition du modèle cybernétique.
Conçu comme une pure fiction, le sujet lacanien n’existe que dans l’horizon de l’ordre symbolique qui le détermine, à la manière d’un circuit cybernétique. C’est du moins ce que Lacan semble soutenir lorsqu’il précise que l’inconscient c’est le discours de l’autre, non pas un autre « abstrait », mais plutôt « le discours du circuit dans lequel je suis intégré ». Ce circuit englobant tout entier le sujet est celui des « portes cybernétisées » dont la chaîne combinatoire fonctionne en dehors de toute subjectivité (ibidem, p. 127). Cette mise à l’écart de la subjectivité au profit d’une logique purement informationnelle sera au centre du projet de la déconstruction.
Dans De la grammatologie, Jacques Derrida situe très explicitement son entreprise philosophique dans le champ de la cybernétique [31]. Se référant directement à Norbert Wiener, il reproche à ce dernier de ne pas avoir poussé jusqu’au bout les conséquences théoriques de l’effondrement des frontières ontologiques entre vivant et non-vivant (ibidem). En ouvrant la voie à une nouvelle ère philosophique, Derrida entend donc prendre au pied de la lettre le renversement épistémologique opéré par Wiener. Par son caractère primordial et a-subjectif, le concept d’écriture se rapproche de la notion cybernétique d’information. Derrida en est très conscient puisqu’il voit dans la formulation mathématique de la théorie de l’information l’ouverture vers une écriture enfin affranchie du phonocentrisme (ibidem, p. 43-44). Comme le souligne l’Américaine Katherine Hayles, la codification binaire du langage informatique annonce, en un sens, la disparition de l’auteur. Ainsi, « la déconstruction est bel et bien l’enfant de l’âge de l’information » [32]. Le philosophe Jean-Pierre Dupuy a d’ailleurs souligné cette continuité d’esprit entre la cybernétique et la déconstruction derridienne [33]. Il faut dire que Derrida considérait que « la conjonction non fortuite de la cybernétique et “des sciences humaines” » constituait l’indice d’un profond bouleversement culturel [34].
L’énorme succès académique et culturel de la déconstruction aux États-Unis n’est certainement pas étranger à son empreinte cybernétique. Tout se passe comme si la radicalisation française du paradigme américain avait permis d’affirmer avec plus de force le renversement épistémologique dont il était porteur. Cela apparaît plus clairement encore lorsqu’on sait que la popularité outre-Atlantique de Derrida repose presque exclusivement, comme le note François Cusset, sur ses œuvres de la première période, c’est-à-dire celles plus proches de la rupture cybernétique, que celles des derrières années [35].
Foucault et le cybernanthrope
Moins directe que chez Lévi-Strauss, Lacan ou Derrida, l’influence du modèle informationnel est néanmoins très présente dans l’œuvre de Foucault. En définissant le pouvoir comme un système de relation et en mettant l’accent sur son caractère discursif, Foucault se situe bel et bien dans le sillage de la rupture cybernétique. Tel qu’il est conçu dans La Volonté de savoir, le pouvoir s’apparente à la notion cybernétique de contrôle ordonnant la production discursive du corps sexué [36]. Sur ce point, Katherine Hayles a montré comment l’idée d’une construction discursive du corps a coïncidé avec la réduction cybernétique de ce dernier au rang de simple support informationnel [37]. Il est vrai qu’en soutenant que le pouvoir « est le nom qu’on prête à une situation stratégique dans une société donnée », Foucault rejoignait la logique purement relationnelle du modèle cybernétique [38]. Cela n’avait pas échappé au sociologue Henri Lefebvre qui, critiquant l’importation structuraliste du concept de système, lançait à propos de Foucault : « Ne s’agirait-il pas de la cybernétique, jusqu’ici ignorée […] par les philosophes purs fussent-ils structuralistes ? » [39]
Au cours de la vague structuraliste, Henri Lefebvre a été l’un des rares intellectuels à avoir perçu l’influence déterminante de la cybernétique. S’indignant contre l’effacement théorique du sujet au profit du système, il considérait le structuralisme comme le fruit d’une importation conceptuelle américaine. Dans Positions contre les technocrates, il reproche à Lévi-Strauss, Foucault et Lacan leur américanisation en mettant l’accent sur le fait « que beaucoup de social scientists ont deux patries, les États-Unis et la France » (ibidem, p. 40). D’un point de vue historique, il ne fait pas de doute que Lefebvre avait vu juste en ce qui concerne l’empreinte cybernétique du structuraliste. C’est toutefois chez Deleuze, Guattari et Lyotard que les racines américaines de la French Theory sont les plus solidement enracinées.
Le postmoderne ou l’ère de la multitude
Figures de proue de la French Theory, Deleuze et Guattari participent de la déconstruction cybernétique du sujet [40]. Contrairement à Derrida, ils ne se réfèrent toutefois pas directement à Norbert Wiener. Leur rattachement au paradigme informationnel passe plutôt par Gregory Bateson à qui ils empruntent notamment le concept de plateau [41]. Membre fondateur des conférences Macy, Bateson fut non seulement le premier à avoir importé le modèle cybernétique en psychiatrie, mais il est celui qui a poussé la logique globalisante de ce dernier le plus loin, renonçant même aux frontières matérielles. Ainsi, l’effacement des frontières entre sujet et objet, entre intérieur et extérieur chez Deleuze et Guattari s’inspire largement de la définition de l’esprit chez Bateson [42]. Produit et traversé par le flux des « machines désirantes », le sujet voit, avec Deleuze et Guattari, son unicité éclater au profit d’une fluidité identitaire marquée du sceau de la multiplicité :
« Il n’y a plus ni homme ni nature, mais uniquement processus qui produit […] et couple les machines désirantes. Toute vie générique : moi et non-moi, extérieur et intérieur ne veulent rien dire. » [43]
Tout comme le concept derridien d’écriture, la notion de multiplicité est a-formelle et a-subjective. Elle prend, chez les auteurs de L’AntiŒdipe, la forme du rhizome, c’est-à-dire d’un embranchement d’interconnexions infinies de machines désirantes.
Si l’influence de Bateson est déterminante chez Deleuze et Guattari, ce sont néanmoins les concepts de multiplicité, de machines désirantes et de rhizome qui révèlent l’ancrage cybernétique de leur pensée. Il suffit de voir comment les militants américains du cyborg, de la multitude et du cyberespace se réfèrent aux deux auteurs pour comprendre qu’il s’agit bien plus d’une poursuite du paradigme informationnel que d’une importation française [44].
Lorsque, témoignant de ses expériences de démultiplications identitaires sur l’Internet, la sociologue américaine Sherry Turkle affirme : « Ainsi plus de vingt ans après avoir rencontré les idées de Lacan, Foucault, Deleuze et Guattari, je les rencontre à nouveau dans ma vie virtuelle », elle confirme l’étroite parenté d’esprit entre les auteurs de la French Theory et la logique informationnelle propre à l’Amérique postmoderne [45]. Rien de surprenant en ce cas de constater qu’un ouvrage comme Mille Plateaux est littéralement devenu « la bible philosophique des cyber-évangélistes » [46]. Sans s’y réduire, on peut difficilement contester que la popularité américaine de Deleuze et Guattari repose, en grande partie, sur ce genre d’interprétation technophile.
Nul besoin de recourir à une grande finesse herméneutique pour saisir que La Condition postmoderne de Lyotard se situe dans le prolongement direct du paradigme cybernétique. Dès l’introduction, on est fixé sur ce point : l’âge postmoderne correspond à une mutation du statut du savoir rendue possible par le développement de l’informatique et des sciences de la communication [47]. Non seulement La Condition postmoderne est truffée de références à la cybernétique, à Bateson et aux théoriciens de Palo Alto, mais toute la logique différentielle du savoir postmoderne repose sur le modèle informationnel. Conçu en termes de « différence », le sujet postmoderne perd en idéal et en autonomie ce qu’il gagne en possibilité d’intégration. Il faut dire que la conception postmoderne de la « différence » est directement liée à une interprétation cybernétique du premier principe de la thermodynamique [48]. C’est en ce sens que Bateson définissait l’information comme « une différence qui crée une différence » [49]. Maître mot des mouvements identitaires postmodernes, la « différence » n’est ni plus ni moins que la transposition culturelle de la thermodynamique. L’horizon entropique de la cybernétique hante en fait la pensée de Lyotard jusque dans ses Moralités postmodernes [50].
L’exception française
Alors que la French Theory et ses descendants poststructuralistes tendent à sortir des campus américains pour s’étendre à la sphère intellectuelle planétaire, le milieu universitaire français reste à l’écart de cette effervescence théorique [51]. Difficile de comprendre ce phénomène si l’on oublie à quel point la French Theory a été marquée du sceau cybernétique. Il faut dire que la popularité mondiale des penseurs poststructuralistes n’est pas étrangère à la fascination culturelle entourant l’Amérique postmoderne. Curieusement, le peu d’ancrage de la French Theory dans sa patrie d’origine atteste de son exception culturelle. Non seulement la France reste attachée à l’héritage des Lumières, mais elle réserve aux auteurs de la French Theory un accueil plutôt tiède. Ce n’est donc pas un hasard si l’importation des courants intellectuels nés de la French Theory a moins d’écho dans le retour en France que dans leur mère patrie américaine. Rien d’étonnant lorsqu’on constate que tant dans ses postulats épistémologiques que dans son ancrage géographique la French Theory est en fait l’American Theory radicalisée.
Au-delà de l’amnésie historique ayant conduit à perdre de vue l’influence déterminante de la cybernétique dans la pensée française d’après-guerre, il faut bien voir que l’exception française au sujet de la French Theory correspond à un « conflit de civilisation » dont les enjeux ne sont rien moins que la définition démocratique du sujet et de son autonomie dans un monde de plus en plus marqué par la logique cybernétique.
Céline Lafontaine
Professeure de sociologie à l’Université de Montréal.
Ses recherches portent sur les enjeux épistémologiques, politiques, économiques et culturels des technosciences.
Article publié dans la revue Esprit, janvier 2005.
Ouvrages publiés :
L’Empire cybernétique. Des machines à penser à la pensée machine, Paris, Le Seuil, 2004.
La Société postmortelle. La mort, l’individu et le lien social à l’ère des technosciences, Le Seuil, 2008.
Nanotechnologies et Société. Enjeux et perspectives: entretiens avec des chercheurs, Boréal, 2010.
Le Corps-marché. La marchandisation de la vie humaine à l’ère de la bioéconomie, Le Seuil, 2014.
Bio-objets. Les nouvelles frontières du vivant, Le Seuil, 2021.
[1] François Cusset, French Theory. Foucault, Deleuze et Co et les mutations de la vie intellectuelle aux États-Unis, Paris, La Découverte, 2003. Voir le compte rendu publié dans la revue Esprit, décembre 2003.
[2] Alain Sokal et Jean Bricmont, Impostures intellectuelles, Paris, Odile Jacob, 1997.
[3] Yves Jeanneret, L’Affaire Sokal ou la querelle des impostures intellectuelles, Paris, PUF, 1998.
[4] Cusset, French Theory…, op. cit., p. 118.
[5] Ibidem, p. 288.
[6] Cet article s’appuie, pour une bonne part, sur l’analyse développée par l’auteur dans L’Empire cybernétique. Des machines à penser à la pensée machine, Paris, Le Seuil, 2004.
[7] Philippe Breton, L’Utopie de la communication, Paris, La Découverte, 1995.
[8] Norbert Wiener, Cybernétique et société. L’usage humain des êtres humains, Paris, Le Monde, coll. 10/18, 1954.
[9] N. Wiener, Cybernétique et société…, op. cit., p. 38.
[10] Sur les liens entre béhaviorisme et cybernétique, voir Lafontaine, L’Empire cybernétique, op. cit., chap. I.
[11] Pour une analyse en profondeur du contexte et du contenu des conférences Macy, voir l’ouvrage de l’historien Steve Joshua Heims, The Cybernetics Group. Constructing a Social Science for Postwar America, Cambridge (Mass.), The MIT Press, 1993. Ainsi que celui de Jean-Pierre Dupuy, Aux origines des sciences cognitives, Paris, La Découverte, 1999.
[12] Heims, The Cybernetics Group…, op. cit., p. 285.
[13] Wiener, Cybernétique et société…, op. cit., p. 140.
[14] Sur la question du transfert de la légitimité culturelle de l’Europe vers les États-Unis, voir le livre de Serge Guilbaut, Comment New York vola l’idée d’art moderne, Paris, Jacqueline Chambon, 1989.
[15] Michel Freitag, « La métamorphose. Genèse et développement d’une société postmoderne en Amérique », dans Société n°12-13, Montréal, hiver 1994, p. 1-37.
[16] Dupuy, Aux origines des sciences cognitives, op. cit.
[17] Claude Lévi-Strauss, Anthropologie structurale, Paris, Pion, 1958, p. 95.
[18] N. Wiener, Cybernetics or Control and Communication in the Animal and the Machine, Cambridge (Mass.), The MIT Press, 1961. Claude Shannon, Warren Weaver, The Mathematical Theory of Communication, Urbana, University of Illinois Press, 1949.
[19] François Dosse, Histoire du structuralisme en France. T. 1 : Le Champ du signe, Paris, La Découverte, coll. Le Livre de poche, 1992, p. 72.
[20] Roman Jakobson, « Le langage commun des linguistes et des anthropologues », dans Essais de linguistiques générales, Paris, Minuit, 1963, p. 32.
[21] Lily Kay, Who Wrote the Book of Life?, Stanford, Stanford University Press, 2000, p. 12.
[22] C. Lévi-Strauss, « Langage et société », dans Anthropologie structurale, op. cit., p. 63-91.
[23] Dosse, Histoire du structuralisme en France, op. cit., p. 410.
[24] C. Lévi-Strauss, L’Homme nu, Paris, Plon, 1971, p. 621.
[25] Wiener, Cybernétique et société, op. cit., p. 49.
[26] Lévi-Strauss, L’Homme nu, op. cit., p. 617.
[27] Lévi-Strauss, « La notion de structure en ethnologie », dans Anthropologie structurale, op. cit., p. 329.
[28] F. Dosse, Histoire du structuralisme en France. T. 2 : Le Chant du signe, 1967 à nos jours, Paris, La Découverte, coll. Le Livre de poche, 1992, p. 263.
[29] Cusset, French Theory…, op. cit., p. 334.
[30] Jacques Lacan, Le Moi dans la théorie de Freud et dans la technique de la psychanalyse, 1954-1955, Paris, Le Seuil, coll. Points Essais, 1978.
[31] Jacques Derrida, De la grammatologie, Paris, Minuit, 1967, p. 19.
[32] Katherine Hayles, How we Became Posthuman, Chicago, The University of Chicago Press, 1999, p. 43-44 (trad. libre).
[33] Dupuy, Aux origines des sciences cognitives, op. cit., p. 176.
[34] Derrida, De la grammatologie, op. cit., p. 21.
[35] Cusset, French Theory…, op. cit., p. 131.
[36] Michel Foucault, Histoire de la sexualité. T. 1 : La Volonté de savoir, Paris, Gallimard, coll. Tel, 1999.
[37] Hayles, How we Became Posthuman, op. cit., p. 192-199.
[38] Foucault, Histoire de la sexualité…, op. cit., p. 123.
[39] Henri Lefebvre, Position contre les technocrates, Paris, Gonthier, 1967, p. 85.
[40] Hayles, How we Became Posthuman, op. cit., p. 4.
[41] Gilles Deleuze et Félix Guattari, Mille Plateaux, Paris, Minuit, 1981.
[42] Gregory Bateson, Vers une écologie de l’esprit (2 t.), Paris, Le Seuil, 1977.
[43] G. Deleuze et F. Guattari, L’Anti-Œdipe, Paris, Minuit, 1972, p. 8.
[44] Le meilleur exemple de ce phénomène demeure l’ouvrage culte d’Antonio Negri et Michael Hardt, Empire, Harvard University Press, 2000.
[45] Sherry Turkle, Life on the Screen: Identity in the Age of the Internet, New York, A Touchstone Book, Simon and Schuster, 1997, p. 15 (trad. libre).
[46] Neil Spilled (éd.), Cyber-Reader. Critical Writing of the Digital Era, New York, Phaion, 2002, p. 96.
[47] Jean-François Lyotard, La Condition postmoderne, Paris, Minuit, 1979.
[48] Lafontaine, L’Empire cybernétique, op. cit.
[49] G. Bateson, Vers une écologie de l’esprit, t. 2, Paris, Le Seuil, 1977, p. 210.
[50] J.-F. Lyotard, Moralités postmodernes, Paris, Galilée, 1973.
[51] Cusset, French Theory…, op. cit.
