Enjeux politiques, économiques, sanitaires, démocratiques et éthiques
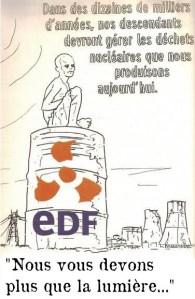 La minimisation des impacts catastrophiques d’un accident nucléaire est en passe de devenir un grand classique de notre temps, et ce non seulement dans les pays où la présence d’installations nucléaires est importante, comme la France, ou dans les pays ayant déjà subi un accident, comme le Japon ou la Biélorussie, mais également dans les pays qui en sont dépourvus. Cette minimisation, qui semble s’imposer avec force, relève de la capacité de « résilience » des nucléaristes, c’est-à-dire des industriels, des Etats nucléaires, ainsi que de certaines instances de régulation, nationales comme internationales.
La minimisation des impacts catastrophiques d’un accident nucléaire est en passe de devenir un grand classique de notre temps, et ce non seulement dans les pays où la présence d’installations nucléaires est importante, comme la France, ou dans les pays ayant déjà subi un accident, comme le Japon ou la Biélorussie, mais également dans les pays qui en sont dépourvus. Cette minimisation, qui semble s’imposer avec force, relève de la capacité de « résilience » des nucléaristes, c’est-à-dire des industriels, des Etats nucléaires, ainsi que de certaines instances de régulation, nationales comme internationales.
Comment les nucléaristes ont-ils réussi à banaliser le mal radioactif à ce point ? Par quels moyens, stratégies et mots d’ordres les instances gouvernantes sont parvenues à formuler le problème en termes de modalités d’évacuation, voire de sa légitimité, alors qu’on devrait plutôt discuter collectivement de la légitimité à continuer à faire usage d’installations qui ont un potentiel de transformation et de destruction inégalé sur les territoires, les ressources naturelles, les espèces vivantes, et les corps humains ?
En partant de ces questions, la présente note [de la Fondation de l’Ecologie Politique] souhaite contribuer à l’avènement d’un débat politique et citoyen, qui n’a que trop tardé, autour de la problématique des territoires contaminés en cas d’accident nucléaire.
*
Three Mile Island ? Les responsables nucléaires français n’y virent dans l’immédiat qu’un « incident » ou un « pépin ». Tchernobyl ? En 1996 encore, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ne comptabilisait que 32 morts. Fukushima ? La catastrophe a paradoxalement accéléré l’offensive de l’industrie nucléaire japonaise en matière d’exportations. Nul autre secteur ne provoque, en cas d’accident, de controverses aussi vives et permanentes (avec des expertises, preuves/non-preuves, observations, et évaluations aussi contrastées et antinomiques), sur les impacts sanitaires dont souffrent les populations victimes.
Au delà des conséquences très graves sur la santé des populations, dont la démonstration ou la reconnaissance sont rendues difficiles en raison du temps de latence que nécessitent les maladies radio-induites pour se manifester, mais aussi du secret ou de la fabrique active d’ignorance qui souvent les entourent, un accident nucléaire signifie également le sacrifice de territoires tout entiers.
L’enjeu pour les nucléaristes, depuis les années 1990 du moins, consiste en effet à minimiser ce sacrifice aux yeux de l’opinion publique. A faire en sorte que le renoncement aux terres n’ait pas lieu, ou n’ait lieu que de façon seulement provisoire. A instrumentaliser, pour cela, la souffrance, certes bien réelle mais aucunement singulière, des évacués pour faire croire que ceux qui restent sur leurs terres, quand bien même elles n’offriraient plus de conditions de vie suffisamment saines, ne souffriraient de rien. A prétendre qu’on peut très bien « apprendre à vivre » avec la radioactivité ambiante.
La première partie de cette note retrace la genèse des débats d’experts, des arrangements juridiques et des outils managériaux relatifs à la gestion des territoires contaminés. Il s’agit ici de rappeler le fait que le caractère ingérable des dégâts provoqués par un accident nucléaire majeur a été reconnu par les experts du nucléaire dès les années 1950, ce qui a historiquement conditionné la doctrine, aujourd’hui dominante, selon laquelle les mesures post-accidentelles (dont l’abandon des zones contaminées) seront nécessairement limitées, voire devraient être optimisées. La deuxième partie de la note se penche sur la manière dont les territoires contaminés ont été effectivement pris en charge dans l’après-Tchernobyl et l’après-Fukushima. Les critères socio-économiques et géo-politiques qui influent sur la manière de concevoir l’avenir des zones évacuées, leurs statuts, et leur impossible « retour à la normale » sont ici analysés. La dernière partie de la note insiste sur l’importance des stratégies officielles visant à psychologiser les catastrophes en vue de minimiser l’abandon des terres contaminées, mais aussi de pousser au second plan la perspective d’une évaluation équitable des dégâts sanitaires engendrés en cas d’accident.
I. Gérer l’ingérable.
Naissance des « zones » comme outil managérial
Des « zones d’exclusion » aux « zones d’évacuation »
Les conséquences catastrophiques d’un accident nucléaire ont été en grande partie étudiées par les experts nucléaires dès les années 1950, bien avant le passage au stade industriel de l’énergie nucléaire. Dès cette période, un consensus fut établi entre experts sur le fait qu’en cas d’accident majeur, de très vastes territoires allaient être contaminés pendant des centaines, voire des milliers d’années. Le fait qu’un nombre très important de personnes devait, en théorie, être évacuées, fut également considéré comme acquis. Cette évidence a par ailleurs largement pesé dans le choix des sites et des politiques urbaines associées. En 1950, un comité d’experts de la Commission de l’énergie atomique (AEC) des Etats-Unis proposa même d’envisager une « zone d’exclusion » pour les sites nucléaires, c’est-à-dire de les isoler complètement au sein d’un large périmètre, de l’ordre de 30 km pour une puissance de 1 000 MWe [1] (la taille du périmètre devant s’accroître en fonction de la puissance installée). Néanmoins, face à la réticence des industriels qui virent dans cette mesure une source d’angoisse et de refus publics vis-à-vis des centrales nucléaires, l’AEC opta en 1956 pour des « zones d’évacuation » à mettre en place en cas d’accident, plutôt que des « zones d’exclusion » à instaurer de facto [2].
En 1957, une équipe de chercheurs du Brookhaven National Laboratory missionnée par l’AEC élabora les premiers scénarios d’évacuation des populations en cas d’accident. Leurs calculs furent extrêmement alarmants : une défaillance majeure survenant dans un réacteur de 500 MWe provoquerait environ 3 400 morts et pas moins de 40 000 irradiés ; elle nécessiterait l’évacuation d’une énorme région d’une superficie de 240 000 km2, plus d’un tiers de la superficie de la France; et son coût financier (dégâts territoriaux et sanitaires) serait de l’ordre de 7 milliards de dollars [3].
Les retombées politiques de cette étude furent immédiates. Afin de protéger l’industrie nucléaire contre de tels risques financiers, l’Etat américain, rapidement suivi par d’autres Etats nucléaires, limitèrent de façon drastique la responsabilité civile des exploitants nucléaires en cas d’accident (Price Anderson Act 1957, Convention de Paris 1960, Convention de Vienne 1966) [4]. Ainsi, face à des risques aussi exceptionnels, l’arrangement juridique et assurantiel mis en place par les Etats en faveur des industriels fut exceptionnel. Ce cadre juridique n’a pas particulièrement évolué depuis. EDF, par exemple, voit sa responsabilité civile limitée à 91 millions d’euros seulement en cas d’accident majeur survenant sur l’un de ses réacteurs. Il s’agit là d’une somme très négligeable au regard du coût réel d’un accident : les estimations relatives au coût de Fukushima oscillent entre 250 et 500 milliards d’euros ; les calculs de coûts avancés par les pouvoirs publics français estiment à environ 430 milliards d’euros le coût moyen d’un accident majeur qui surviendrait dans l’Hexagone [5] (760 milliards, selon un scénario « majorant »).
Dans la ligne du caractère très symbolique des responsabilités financières fixées aux exploitants, la nécessité de catégoriser les dommages, de hiérarchiser les compensations, mais aussi de contrôler la perception publique des risques et dégâts s’est également imposée à partir des années 1960. Une doctrine majeure a été consolidée dans ce cadre : l’évacuation totale des territoires contaminés en cas d’accident majeur est impossible (en termes à la fois technique, économique et d’acceptabilité sociale), de même qu’il est impossible de compenser entièrement les dégâts causés aux personnes et aux biens. Les experts nucléaires ont ainsi jugé qu’à la fois les évacuations et les compensations devaient être « optimisées ». Cette conviction a ouvert la voie à l’émergence d’un outil managérial majeur : le dispositif de zonage.
Le dispositif de zonage : une prise de risque à géométrie variable
Les modalités de zonage étaient déjà esquissées dans l’étude de Brookhaven mentionnée plus haut et connue sous le nom de « Rapport Wash 740 ». Un dispositif en cinq zones fut alors imaginé : une première zone dite d’évacuation urgente (effectuée dans les 12 premières heures après l’accident) ; une deuxième zone d’évacuation pour la mise en place de laquelle un délai supplémentaire est jugé nécessaire ; une zone 3 impliquant une évacuation temporaire ainsi que des restrictions sur l’agriculture ; une zone 4, nécessitant la destruction des récoltes et des restrictions sur l’agriculture ; et enfin une dernière zone, dépourvue de restrictions, mais sujette à des contrôles radiologiques réguliers [6]. Ces critères de zonage inspirèrent fortement ceux qui furent appliqués plusieurs décennies plus tard d’abord à Tchernobyl puis à Fukushima.
Le dispositif de zonage devait permettre aux gouvernements de transmettre un double message. Premièrement, ils pouvaient ainsi affirmer que le problème était (ou allait être) localisé, encerclé, et que par conséquent la menace était sous contrôle. En deuxième lieu, et de façon plus subtile, la « mise en zones » des dommages permettait d’introduire des différences dans les niveaux auxquels les personnes affectées ou victimes de la radioactivité seraient estimées atteintes : l’expérience personnelle d’un dommage subi devrait nécessairement être mise en perspective avec les dommages supportés par d’autres, et sa prise en charge dépendrait aussi de sa gravité relative.
II. De Tchernobyl à Fukushima : des zones en mouvement
Des zones évacuées aux terres à reconquérir
Après l’accident de Tchernobyl comme après ceux de Fukushima, la « zone d’évacuation » fut décrétée dans un premier temps de manière plus ou moins arbitraire : un cercle fut dessiné autour des réacteurs accidentés, à l’intérieur duquel une évacuation urgente fut actée. Le rayon d’évacuation fut de 30 km dans le cas de Tchernobyl, de 20 km dans celui de Fukushima. En France, les plans d’urgence actuels prévoient globalement d’évacuer les abords des sites nucléaires dans un rayon de 10 km ; il s’agit là de plans critiquables et d’ailleurs critiqués pour le caractère inadéquat de la plupart des mesures envisagées, qu’il s’agisse de l’inefficacité des dispositifs d’information à activer en cas d’urgence, de l’incohérence des calculs relatifs aux nombres de personnes censées être protégées moyennant des évacuations ou des mises à l’abri, de l’absence de plans précis d’éloignement, d’accueil ou de prise en charge pour les évacués, ou encore du caractère pour le moins avare des plans de distribution d’iode stable [7].
Dans les jours, les semaines, voire les mois qui ont suivi les catastrophes de Tchernobyl et de Fukushima, les périmètres d’évacuation ont été revus et ajustés à mesure que les cartes de contamination réelle étaient dressées et progressivement affinées. Ce réajustement des zones d’évacuation (ou de restriction) a nécessité pas moins de neuf mois dans le cas de Fukushima, plusieurs années à Tchernobyl. L’évacuation initiale a concerné environ 70 000 personnes au Japon, 90 000 en ex-URSS. Au cours du temps, le nombre d’évacués a atteint les 200 000 au Japon, les 350 000 dans l’ex-URSS (dont certains après la chute du régime soviétique).
Le traitement des zones évacuées fut différent. Dans le cas de Tchernobyl, le retour des populations à ces zones n’a été vraiment envisagé ni par Moscou, ni, à partir de 1991, par les républiques post-soviétiques. Une telle perspective ne fait l’objet d’un débat que depuis tout récemment, notamment en Ukraine. A Fukushima, au contraire, dès le début de l’année 2012, les responsables politiques ont mis en avant la nécessité de « reconquérir » au plus vite la plupart des zones évacuées. Par conséquent, d’énormes travaux de décontamination ont été entrepris pour opérer ce prétendu retour à la normale. L’efficacité et l’adéquation de ces travaux, dont le coût est estimé à environ 50 milliards d’euros, restent pour le moins incertaines, étant donné l’incontrôlable déplacement des radioéléments d’un endroit à l’autre, sous l’effet du vent, des pluies, dans les cours d’eau, etc., mais également à cause du caractère superficiel des mesures entreprises (dont les forêts sont en grande partie écartées), ainsi que l’impasse dans laquelle se trouve la question des déchets radioactifs rassemblés en très grandes quantités et dont on ne sait que faire.
A Tchernobyl, la zone d’évacuation a concerné une ville (Pripyat, 50 000 habitants) et plusieurs dizaines de villages. A Fukushima, elle comprenait au départ cinq petites villes (Namie, Futaba, Okuma, Tomioka, Naraha), des parties d’une ville (Tamura city), ainsi qu’un village (Kawauchi). Naraha, Tamura et Kawauchi ont depuis été recatégorisées comme habitables. Le gouvernement japonais envisage en fait de lever, avant mars 2017, l’ordre d’évacuation de la zone évacuée, hormis une petite zone dite de « retour difficile », dont les niveaux de dose dépassent les 50 mSv (les niveaux autorisés sont de 20 mSv au Japon ; de 1 mSv en France et en Europe). Les compensations sont censées s’interrompre également, dès l’année suivante [8].
Mesure de l’exposition humaine aux rayonnements ionisants produits par la radioactivité
Le Sievert (Sv) est l’unité utilisée pour donner une évaluation de l’impact des rayonnements sur l’homme. 1 millisievert (mSv) est égal à 1 millième de Sievert.
La radioactivité naturelle moyenne en France est de 2,4 mSv par an et par personne. Une radio des poumons expose à une dose de 0,4 mSv. (Source : CEA, Lexique du Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives, http://www.cea.fr )
La limite de dose autorisée pour l’exposition de la population aux rayonnements artificiels (c’est à dire à l’exclusion de l’exposition naturelle et médicale) en France est de 1 mSv sur 12 mois glissants par personne (Code de la santé publique, Article R1333-8).
La limite de dose autorisée pour les travailleurs en France est de 20 mSv sur douze mois glissants par personne (Code du travail, Article R231-76 et réglementation européenne).
Après l’accident de Fukushima, le gouvernement japonais, avec l’aval de l’AIEA, a relevé les doses acceptables pour les travailleurs du nucléaire à 100 mSv par an et même jusqu’à 250 mSv par an dans certains cas. La limite de dose autorisée pour la population a, quant à elle, été élevée à 20 mSv par an.
(Source : C. Asanuma-Brice, « Fukushima, bilan d’une situation sanitaire inquiétante », Citizen-Scientist International Symposium on Radiation Protection, 19 octobre 2015)
Il est à noter qu’au Japon, même la zone dite de retour difficile n’est pas considérée comme étant définitivement abandonnée. Dès août 2013, le gouvernement japonais écartait de fait la catégorie de zone « restreinte » ou « interdite ». Bien qu’il reste des lieux auxquels l’accès est interdit, ils ne sont plus labellisés ainsi car ils ne sont plus considérés comme étant abandonnés de façon permanente. Rebaptisés « territoires où les résidents auront du mal à retourner avant longtemps », tout indique qu’ils feront eux aussi l’objet de stratégies de normalisation, ou au moins de revalorisation à moyen ou long terme. Autrement dit, leur contamination incontournable en radioéléments, dont la demi-vie dépasse des dizaines de milliers d’années pour certains n’est pas considérée comme une donnée pertinente dans la course à la banalisation des terres contaminées.
A Tchernobyl aussi, des efforts de « réhabilitation » ont visé les zones interdites, mais d’une manière différente, c’est-à dire sans que la perspective de les repeupler (par le retour des résidents) soit de mise. Concernant la ville sacrifiée de Pripyat et ses alentours, plusieurs voies furent explorées. Un tourisme national et international de « mémoire » y a pris place, avec des visites groupées à distance du sarcophage. L’AIEA a également milité pour qu’y soit mis en place un tourisme scientifique. La zone interdite a ainsi fait l’objet d’un fort marketing à partir de la fin des années 1990 : les experts de l’AIEA diffusant l’idée que la zone d’exclusion de Tchernobyl, souvent appelée « zone morte », n’est pas morte du tout ; que l’interdiction de toutes activités humaines en a fait un « sanctuaire unique de la biodiversité », abritant désormais, et en grand nombre, de nouvelles espèces végétales et animales [9]. Le fait que ces espèces aient connu d’importantes mutations génétiques, voire que certaines espèces végétales sont littéralement gelées, n’est cependant aucunement mentionné [10].
Le « casse-tête » des évacuations volontaires
Au delà des zones évacuées (temporairement ou définitivement) sur ordre étatique, les zones dites « d’évacuation volontaire » ont une importance tout aussi stratégique pour les nucléaristes. Cette catégorie forgée au début de la décennie 1990 fut insérée dans les nouvelles législations adoptées par les nouveaux Etats indépendants (Ukraine, Biélorussie, Russie). Ces zones ne sont pas, en règle générale, parmi les plus contaminées, mais leurs niveaux de contamination peuvent dépasser, par endroits, les limites autorisées (existence de hotspots). Les habitants/victimes sont alors jugés « libres » d’en partir ou d’y rester. Evidemment, dans les faits, la liberté s’achète, dans le sens que ne partent que ceux qui ont les moyens de partir alors que d’autres sont et seront définitivement condamnés à vivre avec la pollution radioactive.
Après Tchernobyl, de vastes campagnes de communication ont visé et visent encore à convaincre les habitants de ces zones à y rester. Au Japon, tous ceux qui sont partis sur ordre du gouvernement ou de leur propre chef sont aujourd’hui destinataires de telles tentatives de persuasion. Celles-ci s’avèrent particulièrement offensives vers ceux qui sont partis de leur plein gré. En raison de leur refus (tendance majoritaire à l’heure actuelle) de regagner leur territoire d’origine, ils sont la plupart du temps stigmatisés par les experts gouvernementaux ou par les non-victimes comme des individus « peureux et irresponsables » qui entravent l’effort national relatif à la reconstruction de Fukushima [11].
Les enjeux politiques et économiques de la normalisation des zones contaminées
Les zones sont donc conçues, en particulier dans la période récente, en tant que dispositifs socio-techniques mouvants, censés permettre une gestion à la fois autoritaire et flexible des territoires, des populations, et de la santé publique. Leurs frontières n’étant pas rigides, elles sont sujettes à des recatégorisations permanentes. A Fukushima, d’ailleurs, les zones sont non seulement très « dynamiques » puisqu’elles changent de statut rapidement suite à la décontamination, mais elles sont également, aux yeux des dirigeants, précisément vouées à disparaître à une échéance plus ou moins longue [12]. A Tchernobyl, le retour aux zones évacuées ou la suppression de celles-ci ne furent pas une priorité au départ ; après 1991, les évacuations furent même étendues sur initiative des gouvernements biélorusse et ukrainien. Néanmoins, à partir de la deuxième moitié de la décennie 1990, notamment en Biélorussie dont le territoire est à 23 % contaminé, une part importante des zones évacuées allait progressivement être re-catégorisée comme habitable.
Depuis les années 1990 en effet, les organismes internationaux comme l’AIEA, l’OCDE et la Banque mondiale ont régulièrement stigmatisé la tendance post-soviétique à « trop évacuer », considérant que « l’excès d’évacuation » est non seulement irréaliste, mais aussi nuisible à l’économie, à la stabilité politique d’un pays, voire à la santé psychologique et mentale des populations. Pour les industriels et pour de nombreux experts occidentaux, il fallait au contraire œuvrer à la « normalisation » des zones, jugée cruciale en termes à la fois politiques (car il en va de la crédibilité d’un Etat que de rétablir la vie « normale », surtout si, malgré la catastrophe, une sortie du nucléaire n’a pas été décrétée) et économiques (car elle va de pair avec la diminution, voire la suppression des compensations et aides aux victimes). Le retour à la normale des zones contaminées s’imposait par ailleurs, pour assurer l’avenir même de l’industrie nucléaire à l’échelle internationale. En effet, des évacuations trop étendues dans l’espace comme dans le temps étaient et restent à éviter, aux yeux des nucléaristes, parce qu’elles rendent « trop visible » le caractère inacceptable des risques encourus.
Des normes sanitaires anormales pour des zones à « normaliser »
Dans la ligne de ces préoccupations politiques et économiques, il est important de souligner qu’après les accidents de Tchernobyl et de Fukushima, tous les habitants qui, selon les normes de radioprotection en vigueur, devaient être éloignés des territoires contaminés, ne l’ont pas été. Cela a été rendu possible par une révision à la hausse des normes sanitaires. En France, les scénarios officiels partent d’une même hypothèse. Une étude réalisée par l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) quelques années avant Fukushima (étude rendue publique en 2013) arguait que, étant donné l’étendue des terres qui seraient contaminées en cas d’accident majeur en France, les mesures entreprises pour l’évacuation des populations et au-delà se révéleraient nécessairement « sous-optimales » [13]. Plus précisément, un accident survenu dans un des réacteurs de la centrale retenue dans le scénario, celle de Dampierre, théoriquement nécessiterait l’évacuation de plus de 2 millions et demi de personnes, mais dans la pratique, les pouvoirs publics ne procéderaient qu’à l’évacuation de 25 000 personnes, soit 1 sur 100 devant théoriquement être éloignées des lieux contaminés. Les experts de l’IRSN calculèrent aussi que 17 500 cancers supplémentaires seraient provoquées en raison du caractère sous-optimal des mesures prises (du fait de la non-évacuation).
Après Fukushima, pour limiter les évacuations, le gouvernement japonais a multiplié la dose annuelle maximale admissible par 20, passant ainsi de 1 mSv (norme en vigueur en France et en Europe en fonctionnement « normal » des centrales) à 20 mSv (niveau maximal fixé pour les travailleurs du nucléaire en France et en Europe). Pour leur part, les pouvoirs publics japonais considèrent depuis 2011 qu’en-dessous du seuil de 100 mSv, le risque de développer un cancer radio-induit est proche de zéro (le tabagisme ou l’obésité, disent-ils, sont des problèmes plus préoccupants). Ils font ainsi fi du consensus scientifique internationalement établi depuis des décennies sur les effets sanitaires des « faibles doses », modèle linéaire selon lequel on ne peut pas déterminer de seuil en-dessous duquel ces effets seraient considérés nuls. A Tchernobyl, la dose maximale admissible a été également revue à la hausse et fixée à 5 mSv par l’URSS dans l’après-catastrophe, avant de revenir à 1 mSv à partir de 1991. Dans la pratique, un grand nombre de personnes ont continué à vivre dans des territoires où le niveau de radioactivité dépassait 1 mSv, les Etats biélorusse et ukrainien s’avérant incapables de les reloger ailleurs. Selon des données fournies par l’AIEA [14], 15 ans après la catastrophe, ce sont pas moins de 4,5 millions de personnes qui vivaient toujours dans les territoires contaminés ; et le nombre total des victimes officiellement reconnues avait atteint les 7 millions.
Les guides de « réhabilitation participative » : ou comment apprendre à vivre dans un monde contaminé
Pour les évacués qui retournent (ou qui sont appelés à retourner) chez eux, en plus des normes sanitaires exceptionnelles, une gestion par des softlaws ou des guidelines (des conseils) est également à l’œuvre. En effet, les zones initialement évacuées sont normalisées ou « nettoyées » non seulement grâce aux travaux de décontamination mais aussi grâce à la volonté des individus d’obéir aux ordres gouvernementaux. La plupart du temps, les personnes évacuées sont appelées à, et décident de, retourner chez elles malgré la persistance d’une contamination radioactive, certes atténuée, mais constante. Les guides dits de « réhabilitation participative » jouent alors un rôle majeur. Ils visent à former les victimes à ajuster et à optimiser leur alimentation, leurs pratiques, et leurs déplacements au quotidien, afin qu’elles incorporent le moins de radioéléments possible. L’hypothèse des experts est que si les personnes qui sont revenues chez elles continuent à vivre comme avant (et donc si elles ne font pas attention au nouvel état – radioactif – de leur environnement), leur territoire ne pourra plus être considéré comme « normalisé », puisqu’elles vont probablement tomber malades un jour. Si, au contraire, elles adoptent des mesures « simples » (comme si il pouvait être simple de calculer les pour et les contre de chaque geste au quotidien…), si donc elles agissent comme des citoyens responsables dotés d’une « culture radiologique pratique », elles ne seront plus des victimes (ou des malades) mais des habitants maîtres de leurs lieux. Par conséquent, les territoires contaminés sur lesquels ces personnes se réinstallent préserveront eux aussi leur « normalité ».
Ces guides de « réhabilitation participative » ont été conçus par l’équipe Ethos, un groupe d’experts français piloté par des organismes proches des milieux nucléaires [15], et financés par les pouvoirs publics français et par la Commission européenne à partir de la fin des années 1990. Ils ont d’abord été testés en Biélorussie, dans la région de Brest (anciennement Brest-Litovsk). Une telle individualisation de la gestion des risques de la radioactivité était alors promue en tant que forme d’émancipation (empowerment) pour les victimes appelées à devenir des citoyens responsables et éclairés. Les efforts menés par les individus pour s’adapter à de nouvelles conditions – exceptionnelles – de vie (au Japon, les habitants des zones peuvent tous désormais être considérés, en termes de doses de radiations reçues, comme des « travailleurs du nucléaire ») devaient servir aussi à renormaliser, au sens plein, les territoires atteints par la radioactivité, à les rendre à nouveau à la fois accueillants et productifs en termes économiques. En d’autres termes, grâce à la collaboration des victimes, le sacrifice territorial, l’abandon de vastes territoires n’étaient plus à envisager. Cependant, personne ne s’est vraiment soucié de, ni n’a étudié, l’éventuel sacrifice biologique (i.e. le risque sanitaire supporté par les revenants) que cela impliquait.
C’est donc aussi dans l’objectif de re-valoriser économiquement les territoires contaminés que le projet Ethos et d’autres qui l’ont suivi (tels que le programme Core ou le projet Sage) ou qui s’en sont inspirés (tels des projets financés par l’AIEA et la FAO par exemple) ont exploré les voies d’une réouverture à l’exploitation agricole des terres biélorusses contaminées, non seulement dans des régions relativement « peu » contaminées (Brest), mais aussi dans d’autres très radioactives (Gomel et Mogilov). Ces stratégies d’adaptation à la vie contaminée ont été exportées, depuis, à la région de Fukushima, à l’initiative des experts français entre autres. S’il paraît incontestable qu’il faille aider les victimes à s’informer, et à agir vis-à-vis des risques radioactifs qui les menacent, ces initiatives ont ceci de problématique qu’elles sont portées par des experts ou des institutions nucléaires, qui prétendent, par ce biais, auprès de l’opinion publique nationale comme internationale, que les conséquences graves d’un accident nucléaire sont maîtrisées, voire que vivre dans des zones contaminées n’est pas vraiment un problème dès lors qu’on apprend à être « résilient ». Nous sommes là au cœur d’une double stratégie : celle qui instrumentalise, au nom du maintien de l’industrie nucléaire, l’aide technique et humanitaire à laquelle les victimes ont naturellement droit ; et celle qui ringardise et méprise les droits qu’ont tous les êtres humains à vivre dans un environnement sain. A cet effet, d’importants moyens de propagande sont d’ailleurs mobilisés, et vont des réunions d’« information » publique très régulières au Japon, aux prises de parole « expertes » dans les médias appelant à ne pas avoir peur des « zones », à la diffusion de films ou documentaires sur de grandes chaînes de télévision.
III. Vers la disparition de « zones » dans l’après Fukushima ?
De la gestion des dégâts matériels à l’administration de la psychologie sociale
Dès la fin des années 1980, les experts de l’OMS et de l’AIEA, mais aussi ceux de l’OCDE et de la Banque Mondiale ont régulièrement critiqué la gestion postsoviétique des conséquences de l’accident de Tchernobyl. Ce qui était objet de critique n’était pas le fait que l’Ukraine et la Biélorussie n’aient pas réussi à assurer l’évacuation et le relogement qui avait été pourtant promis à nombre de victimes, condamnées de fait à rester dans les zones contaminées. Les experts occidentaux ont au contraire déploré le fait qu’ils avaient promis et voulu faire « trop ». De manière quasi univoque, les expertises pilotées par ces agences internationales ont en effet jugé que les règles d’évacuation et de compensation adoptées par ces pays post-soviétiques étaient trop précautionneuses, économiquement insoutenables, politiquement contre-productives et de fait nuisibles à leur volonté à opérer la transition vers une économie (néolibérale) de marché.
Ainsi par exemple, les experts de l’AIEA suggéraient en 2002 :
« Ouvrir les terres contaminées à l’exploitation économique serait un marqueur puissant dans le processus de retour à la normale, pour les investisseurs potentiels comme en termes de la psychologie des communautés concernées. La question doit être examinée attentivement par ces communautés, qui doivent travailler en lien avec des spécialistes pertinents et des agences gouvernementales locales et nationales. Dans la mesure du possible, on doit considérer que les populations locales ont le choix de vivre et de travailler où ils veulent, à partir du moment où on peut veiller correctement aux intérêts des individus vulnérables, dont les enfants. » [16]
Les aides aux victimes décidées dans l’après Tchernobyl ont également fait l’objet de critiques de la part des experts internationaux. Ceux-ci ont considéré en particulier que la volonté « excessive » d’aider et de compenser les victimes a eu pour conséquence l’instauration permanente d’un système d’assistanat ainsi qu’une forte dépendance des citoyens vis-à-vis de l’Etat. Ils ont aussi avancé qu’une telle gestion a eu pour conséquence la dévalorisation de trop de terres et de ressources, qui selon eux, auraient été injustement labellisés comme contaminés dans leur ensemble. Les politiques soviétiques et postsoviétiques ont également été accusées d’avoir provoqué trop d’anxiété sociale : les évacuations démesurées auraient causé peurs, inquiétudes, traumatismes, dépressions, voire problèmes de santé mentale chez les populations concernées. Les effets sanitaires étaient ainsi minimisés, les effets psychologiques maximisés.
Pour résumer, pour les agences nucléaires internationales, les plus importants dégâts de l’accident de Tchernobyl étaient d’ordre psychologique. Dans le Japon post-2011 aussi, le dommage psychologique est considéré central. Le Comité japonais chargé de gérer les compensations relatives aux dommages nucléaires a forgé dans ce cadre une nouvelle catégorie de dommage, appelé « dommage causé par des rumeurs ». Celui-ci a été défini en tant que dommage occasionné par une « préoccupation vis-à-vis du risque de contamination radioactive des produits ou des services, préoccupation engendrée par des informations largement relayés dans les médias, ou par les principales organisations de consommateurs ou de commerce, et entrainant le refus d’acheter, ou l’interruption de vente, d’un produit ou un service » [17].
Les textes officiels précisent en fait que la reconnaissance même, par l’Etat, de ce type de dommage est imprégnée d’ambiguïté, étant donné qu’une telle catégorisation influe inévitablement sur l’existence même de ce dommage, renforçant ainsi son impact. C’est la raison pour laquelle les « dommages causés par des rumeurs » tout comme « les dommages liés à la santé mentale » (dont on parle fréquemment dans le cas des populations évacuées) sont classés « temporaires ». Il n’est ainsi pas un hasard qu’une part très significative du budget de compensation soit réservée aux « dommages causés par des rumeurs » [18]. Ni le coût de la contamination étendue des terres, ni les coûts sanitaires ne sont considérés comme étant aussi importants que ces dommages.
Ainsi, depuis les premières phases après l’accident, la lutte contre les rumeurs fait l’objet d’un travail politique soutenu qui va du lobbyingfait pour l’obtention de la tenue des prochains Jeux Olympiques à Tokyo, aux « campagnes de solidarité avec Fukushima » (qui invitent les Japonais à acheter et consommer en priorité les produits issus de la région de Fukushima afin de combattre la rumeur), aux méthodes plus dures telles que le renforcement du secret et du contrôle exercé sur les médias, dans tout type de publication relative aux conséquences de Fukushima.
Conclusion
Peut-être encouragé par l’audace du gouvernement japonais, très récemment, ce n’était autre que le directeur de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN), bientôt à la retraite, qui déclarait à la presse [19] qu’il faut réduire autant que possible les évacuations tout en apprenant aux victimes comment s’adapter à leur nouvel environnement contaminé, ce qui éviterait selon lui le « stress » des départs forcés.
Éviter le stress (certes réel) ? Ou bien plutôt éviter la visibilité des dégâts d’un accident, pour mieux permettre à l’industrie nucléaire d’annoncer sa « renaissance » ? Nous l’avons vu, les stratégies visant à minimiser les évacuations, et à « normaliser» les territoires contaminés (moyennant des normes sanitaires anormales, des guides pour « apprendre à vivre avec », ou tout autre arrangement), alors même qu’ils ne pourront plus jamais redevenir normaux au sens propre, sont en fait le moyen, pour l’industrie nucléaire, d’assurer sa survie, de continuer à diffuser le mythe du nucléaire « propre », de rendre ainsi invisibles les dégâts réellement engendrés en cas d’accident. La seule focalisation sur le traumatisme des évacués, moyennant de très gros budgets consacrés à l’étude du phénomène depuis les années 1990, sert quant à elle à rendre inaudible, et de manière délibérée, la souffrance non moins significative de ceux qui ne sont pas, ou n’ont pas pu, être évacués, et qui restent ainsi condamnés à vivre dans un monde contaminé. Mais cette souffrance là n’a paradoxalement pas intéressé les scientifiques et experts mandatés par les pouvoirs publics ou les agences nucléaires internationales. Elle a été réduite au silence, une seconde fois, par le discours désormais dominant qui prétend qu’on peut apprendre à vivre et heureux, dans la contamination radioactive. Tout ceci pose de graves problèmes éthiques et démocratiques, en ce qu’il subordonne l’avenir de nos sociétés à des visions fatalistes, qui déforment la conception même des droits humains de base, dont le droit fondamental des individus à vivre dans un environnement sain.
Au vu de ces enjeux, les Français préféreraient-ils vraiment, à tout prix, rester dans leur commune/ville/village d’habitation en cas d’une contamination radioactive permanente, afin d’éviter le stress de déplacement, et/ou assurer que leur propriété ne perde pas trop de valeur, et ce au détriment de leur santé ? Si les responsables nucléaires ont beau affirmer que oui, et que les experts officiels en ont fait leur hypothèse tout aussi implicite que romantique (le déracinement serait le plus insoutenable de tout ce qui peut arriver à un individu), aucune enquête d’opinion commanditée par les instances décisionnelles, aucun groupe d’experts chargé de s’occuper de la psychologie sociale, aucun baromètre IRSN, n’a jugé la question digne d’intérêt. La question reste donc ouverte, et devrait en réalité faire l’objet d’une vaste consultation publique, voire d’un vaste débat européen (le nuage radioactif ne connait pas de frontières), étant donné que les experts les plus officiels reconnaissent désormais qu’un accident grave est possible, voire probable, en France et qu’il peut contaminer de manière irréversible l’ensemble du territoire national.
Sezin Topçu,
docteure en sociologie des sciences et des techniques, chargée de recherche au Centre national de la recherche scientifique (CNRS) et enseigne à l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS).
Elle est l’auteure de La France nucléaire. L’art de gouverner une technologie contestée (Le Seuil, 2013) et a codirigé l’ouvrage Une autre histoire des Trente Glorieuses. Modernisation, contestations et pollutions dans la France d’après-guerre (avec Christophe Bonneuil et Céline Pessis, La Découverte 2013).
La Fondation de l’Ecologie Politique – FEP Note n°8 – Mai 2016.
Principaux sigles d’organismes utilisés :
AEC : Atomic Energy Commission (Commission de l’énergie atomique des Etats-Unis)
AIEA : Agence internationale de l’énergie atomique (ou en anglais IAEA pour International Atomic Energy Agency)
ANCCLI : L’Association nationale des comités et commissions locales d’information
CEA : Commissariat à l’énergie atomique (devenu en 2010 : Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives)
CEPN : Centre d’études sur l’évaluation de la protection dans le domaine nucléaire.
FAO : Food and Agriculture Organization (Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture).
IRSN : Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
OCDE : Organisation de coopération et de développement économiques.
OMS : Organisation mondiale de la santé.
[1] Le symbole « MWe » est l’abréviation de « mégawatt électrique ». C’est l’unité de mesure utilisée pour décrire la puissance maximale produite sous forme électrique par les centrales.
[2] C. Foasso, Histoire de la sûreté de l’énergie nucléaire en France (1945-2000): technique d’ingénieur, processus d’expertise, questions de société, Thèse de doctorat en histoire, Université Lumière Lyon II, 2003, pp. 80, 86, 87.
[3] Rapport WASH-740, « Theoretical Possibilities and Consequences of Major Accidents in Large Nuclear Power Plants », United States Atomic Energy Commission, 1957.
[4] S. Topçu, « Organiser l’irresponsabilité ? La gestion (inter)nationale des dégâts d’un accident nucléaire comme régime discursif », Ecologie et politique n°49, p. 95-114.
[5] Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire, « Le coût économique pour deux scénarios d’accident », 3 mars 2013.
[6] Rapport WASH-740, op.cit., Appendice D.
[7] ANCCLI, « Sûreté nucléaire : quel est le prix à payer ? », Dossier de presse, 5 avril 2016.
[8] Pour plus de détails, cf. D. Boilley, « Le retour à l’anormale », Rapport pour Greenpeace Belgique, 2016.
[9] International Atomic Energy Agency, « Chernobyl’s Legacy: Health, Environmental and Socio-Economic Impacts », avril 2006.
[10] R. Loury, « Tchernobyl: les écosystèmes paient le prix fort », Journal de l’Environnement, 26 avril 2016.
[11] R. Hasegawa, « Returning Home after Fukushima. Displacement from a nuclear disaster and international guidelines for internally displaced persons », Migration, Environment and Climate Change : Policy Brief Series, 4, 1, 2015, p. 1-8.
[12] C. Asanuma-Brice, « Fukushima : temps de la fin contre fin des temps », Sciences et Avenir, mars 2016.
[13] Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire, « Examen de la méthode d’analyse coût-bénéfice pour la sûreté », Rapport DSR n°157, 2007
[14] International Atomic Energy Agency, The Human Consequences of the Chernobyl Accident. A Strategy for Recovery, 2002, p. 32.
[15] Le pilotage d’Ethos a été confié à Mutadis (un cabinet de consulting spécialisé dans la gestion sociale du risque, particulièrement dans le domaine nucléaire) en partenariat notamment avec le Centre d’études sur l’évaluation de la protection dans le domaine nucléaire (CEPN). Rappelons que ce centre d’études est doté d’un statut d’association loi 1901 mais n’a que quatre membres : EDF, Areva, le CEA et l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Voir : S. Topçu, La France nucléaire. L’art de gouverner une technologie contestée, Paris, Le Seuil, 2013, Chap. 7.
[16] International Atomic Energy Agency, 2002, op. cit., p. 13.
[17] OCDE/AEN, « Japan’s Compensation System for Nuclear Damage. As Related to the Tepco Fukushima Daichi Nuclear Accident », Rapport du Bureau des Affaires Juridiques, 2012, p. 57.
[18] Ibidem, p. 59.
[19] R. Loury & V. Laramée de Tannenberg, « Jacques Repussard vous salue bien », Journal de l’environnement, 18 février 2016.
